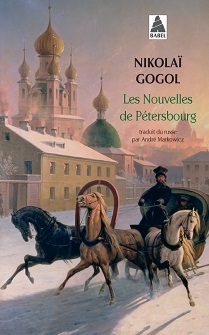Comme j’avais déjà lu, l’année dernière, avec grand plaisir Les Soirées du hameau de Nicolas Gogol, j’ai eu envie de plonger, cette année, dans quelques unes des Nouvelles de Pétersbourg de ce même écrivain.
Je vous présente aujourd’hui quatre d’entre elles : La Perspective Nevski, Le Nez, Le Manteau, Les Carnets d’un fou.
Si vous souhaitez lire ma chronique de l’année dernière sur Les Soirées du hameau, vous pouvez retrouver l’article en cliquant ici !
Note Pratique sur le Livre
Editeur : Actes Sud (Babel)
Première date de publication : 1842
Traduit du russe par André Markowicz
Nombre de Pages : 376 (+30 pages de Postface)
Présentation de Trois de ces Nouvelles :
La Perspective Nevski (58 pages) :
Les premières pages de cette nouvelle nous décrivent la Perspective Nevski – la rue la plus importante et la plus célèbre de Saint-Pétersbourg – telle qu’elle apparaît aux différentes heures du jour, avec des populations bien particulière selon les moments. A l’aube, c’est une fréquentation de mendiants, puis d’ouvriers, puis d’écoliers, etc. Il semble que toutes les classes de la société, des plus misérables aux plus huppées, défilent tour à tour sur la Perspective Nevski.
Puis la nuit arrive et nous nous attachons plus particulièrement au sort de deux promeneurs : Piskariov, un jeune peintre idéaliste, et Pirogov, un lieutenant. Chacun croise une jeune femme et va entreprendre de la suivre. Piskariov, le sentimental, va ainsi s’éprendre d’une très belle prostituée. Et Pirogov, qui serait plutôt un libertin, va faire la cour à une femme mariée assez idiote. (…)
Le Nez (44 pages) :
Un matin, le barbier pétersbourgeois, Ivan Iakovlevitch, s’aperçoit qu’il y a un nez dans le pain de son petit-déjeuner. Sa femme lui commande d’aller se débarrasser de ce nez, soupçonnant son mari de l’avoir coupé par inadvertance à l’un de ses clients. Mais le barbier est sans cesse dérangé, dans les différents coins de la ville, dès qu’il essaye de jeter cet appendice… jusqu’au moment où il est arrêté par un gendarme.
Parallèlement, un autre Pétersbourgeois, l’assesseur de collège Kovaliov découvre, en se levant le matin, que son visage est plat et lisse comme une crêpe : il a perdu son nez ! Cela tombe mal car il avait justement des projets de mariage avec une jeune fille de la meilleure société. Kovaliov décide de passer une annonce dans le journal pour retrouver son nez mais le garçon du journal refuse sa demande incongrue. Un peu plus tard, l’assesseur de collège croise dans une église son nez qui a été élevé à la dignité de conseiller d’Etat et qui porte un superbe uniforme, brodé d’or. Mais, bientôt, la police vient rapporter à Kovaliov son nez qui a été arrêté. Le seul problème c’est qu’il s’avère impossible de le remettre à sa place. (…)
Le Manteau (52 pages) :
Akaki Akakievitch Bachmatchkine, le héros de cette nouvelle, est un petit fonctionnaire, au caractère effacé, qui est employé dans un bureau à faire des copies de documents. Son allure peu soignée et son air distrait en font la risée de ses collègues, qui n’hésitent pas à le brimer, à le vexer. Un jour Akaki Akakievitch s’aperçoit que son manteau est très usé, et il va l’apporter chez le tailleur pour une réparation. Mais le tailleur refuse : le manteau est en trop mauvais état, il faut en acheter un autre. Comme Akaki Akakievitch a des moyens modestes et qu’un nouveau manteau coûte très cher, il commence à économiser, kopek après kopek. Finalement, il parvient à acquérir l’objet de ses désirs. Et ses collègues décident de faire une grande fête, un soir, pour célébrer cette acquisition. Mais, au sortir de cette fête, en rentrant chez lui, Akaki Akakievitch se fait voler son nouveau manteau dans les rues sombres de Saint-Pétersbourg. Pour la première fois de sa vie, le malheureux se révolte contre le sort et entame des démarches pour récupérer son cher manteau. Malheureusement, un « personnage considérable et important » auquel il demande secours s’en prend violemment à lui afin d’impressionner une connaissance qui lui rendait visite. C’est le coup de grâce pour Akaki, qui meurt de froid quelques jours plus tard. C’est alors que commencent à se produire des événements inexplicables. (…)
(Sources de toutes ces présentations : moi et Wikipédia)
**
Mon avis en bref
Ce sont quatre nouvelles dans lesquelles on retrouve, de l’une à l’autre, quelques motifs récurrents. Par exemple, il est question de nez, de façon épisodique, dans plusieurs d’entre elles. Il faut remarquer également qu’il est souvent question de petits fonctionnaires qui ne sont pas très heureux dans leur travail et qui s’interrogent parfois sur le bien fondé de leur hiérarchie, sur leur possible avancement ou sur leur place parmi leurs collègues. Ainsi le héros des Carnets d’un fou conteste le pouvoir de ses chefs et se sent au même niveau qu’eux – voire carrément au-dessus quand il finit par se prendre pour le roi d’Espagne ! Quant au héros du Manteau, qui est au contraire un homme effacé et en butte aux vexations de ses collègues, on peut dire que son nouveau manteau, si chèrement acquis, symbolise la dignité et l’honneur retrouvés. Car c’est pour ce vêtement qu’il est soudain prêt à relever la tête et à se battre. On peut remarquer que le héros du Nez a quant à lui « perdu la face » et qu’il n’a plus « le bon profil » pour mener à bien ses ambitions. Car, en perdant son nez, il se rend compte que ses beaux projets de mariage tombent à l’eau du même coup. Et c’est tout son prestige social qui semblait tenir dans son appendice nasal, organe de l’olfaction et peut-être du flair des bonnes opportunités de la vie. Ce n’est d’ailleurs pas si absurde que cela, à la réflexion, de retrouver ensuite ce nez sous les apparences d’un conseiller d’Etat et vêtu d’or ! J’ai vu, là encore, tout un symbolisme autour des notions d’ambition, d’ascension sociale, de dignité, ou des masques sociaux que nous sommes amenés à afficher dans nos vies et qui peuvent de temps en temps nous trahir.
Un magnifique recueil de nouvelles – à la fois profond et facétieux – qui séduira assurément les amateurs de classiques russes !
**
Un Extrait de « La Perspective Nevski » Pages 62-63
(avant-dernière page de la nouvelle)
« Quelle merveille que notre monde ! me disais-je avant-hier, me promenant sur la Perspective Nevski et repensant à ces deux aventures. Comme le destin se joue de nous d’une façon étrange, mystérieuse ! Obtenons-nous un jour ce que nous désirons ? Atteignons-nous un jour ce vers quoi, semblait-il, nous avions bandé toutes nos forces ? Tout se passe à rebours. À l’un, le destin donne une paire de chevaux splendides, et il s’en sert en restant insensible à leur beauté – alors que l’autre, dont tout le cœur brûle de passion chevaline, fait de la marche à pied et se contente de claquer la langue quand un coursier passe devant lui. Un tel possède un cuisinier hors pair, mais, par malheur, une bouche si petite qu’il ne peut pas y faire entrer, quoi qu’on y fasse, plus de deux petites bouchées ; l’autre a une bouche grande comme l’arche de l’entrée du Grand État-Major, mais, las ! Il doit se contenter d’un pauvre repas allemand de pommes de terre. Comme notre destin se joue étrangement de nous ! «
**
Un Extrait du « Nez » page 95
L’assesseur de collège, après le départ de l’inspecteur, resta quelques minutes dans un état indéfini et eut beaucoup de mal, au bout de quelques minutes, à retrouver sa faculté de voir et de sentir ; tellement cette joie inattendue l’avait plongé dans un état second. Il prit délicatement son nez retrouvé dans le creux de ses deux mains, et le scruta, une nouvelle fois, de toute son attention.
– Oui, c’est lui, c’est bien ! dit le major Kovaliov. Voilà même le petit bouton sur le côté gauche qui avait surgi hier.
Le major faillit en rire de joie.
Mais rien n’est durable en ce monde, et c’est pourquoi la joie n’est plus aussi vivace la minute d’après ; une troisième minute, et elle devient encore plus faible et elle finit par se fondre dans l’état habituel de votre âme, comme un rond dans l’eau, issu de la chute d’un caillou, finit par se confondre dans la surface lisse. Kovaliov s’était mis à réfléchir et avait compris que l’affaire n’était pas encore réglée : le nez était retrouvé, mais il fallait le fixer, le réinstaller à sa place.
– Et s’il ne se refixait pas ?
A cette question, qu’il s’était faite à lui-même, le major blêmit.
(…)
**
Un Extrait des Carnets d’un fou Page 301
86 martobre.
Entre le jour et la nuit.
Aujourd’hui, j’ai reçu la visite de notre huissier pour que je me rende au bureau, du fait qu’il y a déjà plus de trois semaines que je n’occupe plus ma fonction. Pour plaisanter, je me suis rendu au bureau. Le chef de bureau pensait que je m’inclinerais devant lui et que je chercherais à m’excuser, mais j’ai posé sur lui un regard indifférent, sans trop de colère, sans trop de bénévolence, et je me suis assis à ma place, comme si je ne remarquais personne. Je regardais toute cette canaille du département et je me disais « Et s’ils le savaient, qui ils ont parmi eux… Mon Dieu, ce cirque qu’ils auraient fait, même le chef de bureau se serait mis à me faire des courbettes jusqu’à terre, comme il le fait maintenant devant le directeur. » On a mis des papiers devant moi, pour que j’en fasse des comptes rendus. Je n’ai même pas bougé le petit doigt. Au bout de quelques minutes, tout s’est mis à s’agiter. On disait que c’était le directeur qui arrivait. Plein de fonctionnaires se sont précipités, en se bousculant, juste pour se montrer. Je n’ai pas bougé. Quand il a traversé tout notre service, ils ont tous boutonné tous les boutons de leur frac ; moi – rien ! Et alors, un directeur ? que je me lève devant lui ? – jamais ! C’est un directeur, lui ? Ce n’est pas un directeur, c’est un bouchon. Un bouchon ordinaire, un bouchon simple, rien d’autre. De ceux qui servent à boucher les bouteilles. (…)
**
Le compositeur Chostakovitch (1906-1975) a composé en 1927-28 un opéra à partir du Nez de Gogol, précisément intitulé Le Nez et je vous renvoie au superbe article de Jean-Louis sur son blog Tout l’opéra ou presque : à consulter en suivant ce lien !
**