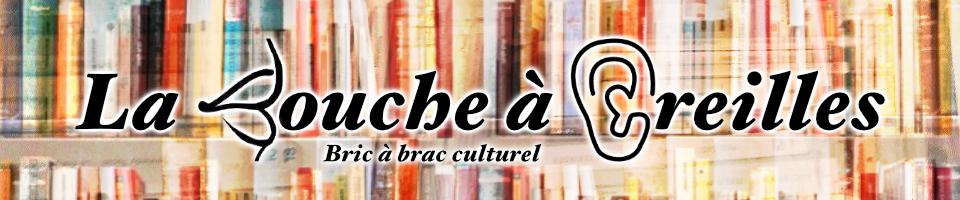J’avais acheté ce recueil poétique, Mariées Rebelles, de Laura Kasischke il y a peut-être un an ou deux. Après l’avoir laissé dormir sur mes étagères, voici que la curiosité m’a de nouveau poussée vers lui.
Une poésie riche en images mais souvent marquée par la mort, la violence, les pensées amères, aigres, ou franchement acides. Pratiquement à chaque page, une évocation sanglante surgit, plus ou moins développée. Marie Desplechin, dans la préface, insiste sur le côté morbide de cette poésie et c’est indéniable. Un certain féminisme peut aussi apparaître, mais adjoint ou mélangé à d’autres thèmes, comme les relations familiales ou l’amour. Les relations hommes-femmes ne sont pas traitées sous un angle sentimental, c’est le moins qu’on puisse dire, mais toujours sous un aspect rude, acerbe, dangereux.
Note pratique sur le livre
Editeur : Page à page
Première année de publication (en français) : 2016 (en américain) 1992
Edition bilingue.
Traduit de l’anglais (américain) par Céline Leroy
Préface de Marie Despléchin
Nombre de pages : 184
Note sur la poète
Laura Kasischke est née en décembre 1961, dans le Michigan. Elle se fait d’abord connaître comme poète, au début des années 90. En 1997, elle publie son premier roman « A suspicious river« . Elle est également nouvelliste. On a pu comparer son style à celui de Joyce Carol Oates. Ses romans sont publiés en français chez l’éditeur Christian Bourgois, sa poésie et ses nouvelles chez Page à page.
Biographie succincte de Breughel
Pieter Brueghel ou Bruegel dit l’Ancien, parfois francisé en Pierre Brueghel l’Ancien est un peintre et graveur brabançon né vers 1525 et mort le 9 septembre 1569 à Bruxelles dans les Pays-Bas espagnols.
Avec Jan Van Eyck, Jérôme Bosch et Pierre Paul Rubens, il est considéré comme l’une des grandes figures de la peinture flamande, et l’une des principales de l’Ecole d’Anvers.
Il est le père des peintres Pieter Brueghel le jeune (1564-1636) et de Brueghel de Velours (1568-1625).
(Source : Wikipédia)
*
Je vous propose ce poème inspiré par le tableau Le Massacre des Innocents (peint vers 1565-66) de Pieter Brueghel, lui-même inspiré par le fameux récit biblique entourant la naissance du Christ.
Page 71
Le Massacre des innocents
D’après Pieter Brueghel
De pâles rubis gouttaient des branches
comme de rouges joyaux taillés dans la glace, et Rachel
pleurait. Et la neige froide
de Bethléem, de Flandre.
Les soldats se déplaçaient lentement
comme une forêt, empressés
et confus comme des animaux métalliques. Hérode
dormait. Rachel
refusait d’être consolée. Cache
les enfants, crièrent-ils. Tiens
les enfants plus haut. Mais
le monde se dénouait. L’avenir
les avait trouvés. L’étang
était gelé au cœur
et blanc comme une aile.
Et personne ne les sauva. Non. Dieu
s’enfuit en Égypte, à dos d’âne
dans la neige, la neige
froide d’Égypte, de Flandre, de France.
On vit une étoile exploser
à l’est, juste
au-dessus d’eux. Ils auraient pu se cacher, mais
aucun ange ne leur
apparut. Les soldats arrivèrent
immobiles et gris, et leurs mères
les implorèrent, et l’on entendit une voix
trop tard, plaintive. Dans la neige
froide de l’Oklahoma,
à Dachau ou au Pérou. Une lamentation
plaintive et sonore.
Un vieil homme tomba à genoux
et supplia qu’on lui rende
le bébé. Cap
de Bonne Espérance.
*