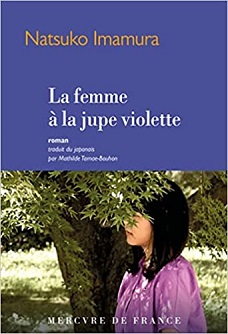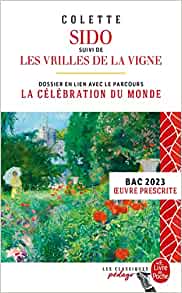Mon amie Pascale, grande spécialiste de littérature japonaise, m’a prêté ce roman en me faisant part de sa perplexité à son sujet et en me prévenant qu’il était un peu déroutant.
Comme je ne connaissais pas cette écrivaine, traduite ici pour la première fois en français, et que ce roman a eu un énorme succès au Japon (Prix Akutagawa – équivalent du Prix Goncourt pour la France) mais aussi à l’étranger (traduit dans une dizaine de langues), j’ai été curieuse de le découvrir.
Par ailleurs, cette lecture s’inscrit dans mon Mois Thématique sur le Japon.
Note pratique sur le livre
Editeur : Mercure de France
Année de publication en français : 2022 (au Japon : 2019)
Traduit du japonais par Mathilde Tamae-Bouhon
Nombre de pages : 117
Note biographique sur l’écrivaine
Natsuko Imamura est née en 1980 dans la Préfecture d’Hiroshima et elle vit à Tokyo. Autrice de quatre précédents ouvrages, tous couronnés par des prix littéraires au Japon, elle a reçu pour La Femme à la jupe violette le plus prestigieux d’entre eux, le prix Akutagawa. Aussitôt best-seller, le roman a été traduit dans dix langues. C’est son premier livre publié en France.
(Source : éditeur).
Quatrième de Couverture (Extrait)
Dans mon quartier habite une personne surnommée « la femme à la jupe violette ». On l’appelle ainsi car elle porte toujours une jupe de couleur violette… Régulièrement, à quinze heures, elle se rend à la boulangerie pour y acheter une brioche à la crème, puis traverse la galerie marchande pour rejoindre le parc tout proche. Là, elle va s’asseoir sur le banc le plus au fond, toujours le même, et déguste sa brioche en utilisant sa main comme soucoupe… Elle ne change absolument rien à sa routine.
Qui est donc cette mystérieuse femme qui ne s’adresse jamais à personne et obéit à un rituel immuable ? C’est ce qui semble obséder celle qui l’observe constamment à la dérobée, la suit partout dans ses allées et venues, toujours de loin, sans chercher à lui parler, une femme au « cardigan jaune » cette fois ? Qui sont-elles ? Comme la première paraît ne pas avoir de travail, la seconde dépose sur son banc attitré des petites annonces intéressantes, puis va jusqu’à la porte de son appartement laisser des échantillons de produits de beauté pour qu’elle soigne mieux son apparence. Pourquoi tant d’attentions portées à une inconnue ?
Mais est-ce vraiment une inconnue ? Et va-t-il falloir que se produise un drame pour que – peut-être – le voile se déchire enfin ?
Mon Avis
Mon amie avait raison de trouver ce roman étrange et de se sentir perplexe à son sujet car c’est ce qu’on peut ressentir devant une telle histoire.
L’étrangeté du livre tient à deux choses : premièrement, l’héroïne dont nous suivons sans cesse les faits et gestes nous semble avoir un comportement bizarre, inexplicable. Au début, elle nous est présentée plus ou moins comme une clocharde ou en tout cas une marginale. Et puis, peu à peu, elle devient différente, elle trouve du travail, elle s’épanouit dans sa vie personnelle et professionnelle, elle change d’apparence et devient plus sociable, et on en arrive à se demander qui elle est vraiment, si ses apparences ne sont pas trompeuses. Mais le personnage le plus bizarre du livre n’est pas du tout celle que l’on imagine à première vue – ce n’est pas celle qui est observée mais celle qui la surveille sans arrêt, qui la suit partout et qui a développé une véritable obsession à son propos, sans que l’on sache pourquoi.
C’est justement cette énigme, de ne pas savoir qui est la narratrice et pourquoi elle semble tellement se passionner pour la femme à la jupe violette, qui m’a tenue en haleine jusqu’au bout et qui a éveillé ma curiosité. Je voulais savoir et, peut-être, comprendre.
Malheureusement, la fin n’apporte pas réellement une réponse claire et limpide et on reste sur sa faim, un peu frustré quand même.
Ce que l’on comprend par contre c’est que la narratrice n’est pas aussi bienveillante qu’on ne pouvait l’imaginer et que ses intentions ne sont pas des meilleures, contrairement à ce qu’elle prétendait jusque-là.
Du point de vue de l’écriture, je n’ai pas été emballée. C’est un style plat, banal, peu recherché. Les dialogues sont peu intéressants et manquent de concision ; on pourrait aussi bien les supprimer, la plupart du temps.
Un roman qui m’a laissé un goût mitigé. Je ne suis pas trop convaincue…
**
Un Extrait page 57
C’est en proie à un sentiment de frustration que j’épie leur conversation. Car, enfin, la femme à la jupe violette ne daigne même pas mentionner le fait qu’on lui a attrapé le nez dans le bus.
Elle ne croit quand même pas que c’est la même personne qui lui a mis la main aux fesses et pincé les narines ? Alors que non, pas du tout. C’est moi qui lui ai pincé le nez.
Le lendemain matin, je fais la queue à l’arrêt de bus, déterminée. C’est décidé : une fois encore, je vais attraper le nez de la femme à la jupe violette. La veille, toutes sortes de personnes l’ont interpellée. Comment, on vous a molestée ? Rude matinée que vous avez eue… « C’est vrai, répondait-elle à chacun d’un ton léger. On m’a mis la main aux fesses dans le bus… »
Pour autant que je sache, cependant, pas une seule fois elle n’a évoqué l’autre attouchement qu’elle a subi. Je suis pourtant sûre d’avoir touché le nez de quelqu’un. Me serais-je méprise ? Pire, aurais-je attrapé l’appendice nasal d’un parfait inconnu ? Aucune idée. Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des choses, c’est comme si mon geste n’avait jamais eu lieu.
Voilà pourquoi je vais le refaire. Et cette fois j’y mettrai toutes mes forces, jusqu’à lui griffer la peau et la faire saigner.
Alors, peut-être, la femme à la jupe violette me fera-t-elle jeter hors du bus, furieuse. Peu importe. J’en profiterai pour décliner mon identité, lui présenter mes excuses, implorer son pardon, après quoi nous deviendrons amies.
(…)