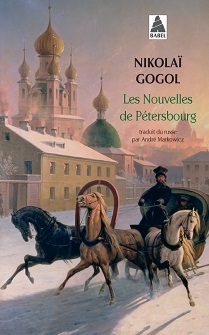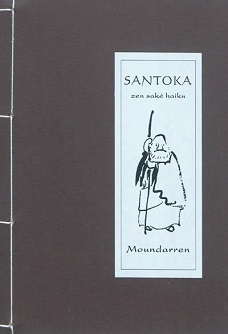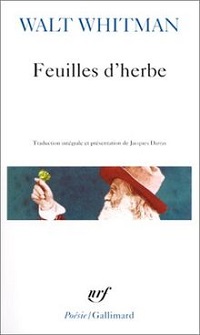Mon ami poète Denis Hamel m’avait conseillé depuis déjà quelques années ces lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. J’ai finalement proposé ce livre à mon cercle de lecture et c’est dans ce cadre stimulant et motivant que j’ai pu me décider à le lire. J’en ai été tout à fait éblouie et émue, découvrant le grand talent littéraire de Vincent Van Gogh, en même temps que sa personnalité attachante, complexe et d’un courage assez admirable!
Cette lecture prend place, bien sûr, dans Le Printemps des artistes.
Et cette chronique rentre aussi dans le cadre du défi « un classique par mois » de l’écrivain, poète, éditeur et blogueur Etienne Ruhaud : il s’agit de découvrir chaque mois un auteur classique que l’on n’a encore jamais lu. Voici le lien vers son blog Page Paysage.
Note Pratique sur le Livre
Editeur : Gallimard (L’Imaginaire)
Date de Publication initiale : 1953 (pour cette version)
Traduit du néerlandais par Louis Roëdlant
Introduction et chronologie de Pascal Bonafoux
Nombre de pages : 567
Quatrième de Couverture
«La première lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, datée d’août 1872, est envoyée de La Haye. Il a dix-neuf ans. Il ne sait pas qu’il va peindre. La dernière lettre, inachevée, Théo la trouve dans la poche de Vincent qui s’est tiré une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise. Des dizaines de toiles encombrent sa chambre. Presque quotidiennement, pendant dix-huit ans, Vincent a écrit à Théo. Et Vincent écrit à propos de tout à Théo comme il lui envoie toutes ses toiles. Il lui montre ce qu’il peint comme ce qu’il est. Ces lettres incomparables – des récits, des aveux, des appels – sont nécessaires pour découvrir le vrai Van Gogh devenu mythe… Il n’est pas un peintre fou. Au contraire, solitaire, déchiré, malade, affamé, il ne cesse d’écrire, lucide, comme il traque la lumière.» Pascal Bonafoux.
Mon Avis
On connaît bien sûr les grandes lignes de la biographie de Van Gogh : son désir de devenir prédicateur dans sa jeunesse, sa grande proximité avec son frère Théo qui a subvenu à ses besoins durant toute sa vie, le fait qu’il n’a vendu qu’un seul tableau de son vivant, son atelier à Arles, sa fréquentation régulière des prostituées, son amitié houleuse avec Gauguin qui s’est finie par le coupage de son oreille, ses séjours à l’asile de fous où il continuait à peindre obstinément, son amitié avec le docteur Gachet dont il a fait un célèbre portrait, son suicide par un coup de pistolet dans la poitrine. Et naturellement on retrouve la plupart de ces épisodes racontés par Vincent lui-même à travers cette correspondance, ce qui est assez passionnant car il a une grande intelligence et une sensibilité extrêmement forte, comme on s’en doute.
La chose qui revient le plus souvent dans ces lettres c’est le terrible manque d’argent : sans cesse il demande à Théo une aide supplémentaire. On voit qu’il se prive de la plus simple nourriture et de vêtements corrects pour pouvoir acheter ses pinceaux, ses couleurs et toutes les fournitures nécessaires à son activité.
Dans chacune de ses lettres ou presque il manifeste son besoin de travailler, de peindre, et l’idée qu’il doit s’appliquer à faire des progrès dans son art semble très présente chez lui.
À certains moments il se considère comme un raté et d’autres fois il pense être sur la bonne voie mais devoir encore s’améliorer. Il ne semble pas avoir conscience de son génie et mise avant tout sur un travail acharné, obsessif. Plusieurs fois revient sous sa plume l’idée qu’il n’est qu’un maillon d’une chaîne plus importante, qui dépasse son propre destin individuel. En bref, il ne pense pas être arrivé à quelque chose, lui tout seul, mais il espère que des continuateurs, après lui, parviendront à un résultat – ce qui est tout de même d’une modestie extraordinaire.
Son admiration pour Gauguin paraît très profonde, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan amical et humain. Van Gogh nourrit l’espoir de créer un grand atelier à Arles, dans lequel il pourrait inviter plusieurs autres peintres et, ainsi, partager les frais, mais aussi travailler ensemble et se soutenir mutuellement. Il commence à mettre sur pied ce projet, en espérant pouvoir y associer Gauguin, mais tous ces projets échouent lamentablement et on a l’impression qu’il ne va jamais se remettre de cet échec cuisant.
**
Un Extrait page 102
Je t’écris un peu au hasard ce qui me vient dans ma plume, j’en serais bien content si en quelque sorte tu pouvais voir en moi autre chose qu’une espèce de fainéant.
Puisqu’il y a fainéant et fainéant qui forment contraste.
Il y a celui qui est fainéant par paresse et lâcheté de caractère, par la bassesse de sa nature, tu peux si tu juges bon me prendre pour un tel.
Puis il y a l’autre fainéant, le fainéant bien malgré lui, qui est rongé intérieurement par un grand désir d’action, qui ne fait rien, parce qu’il est dans l’impossibilité de rien faire, puisqu’il est comme en prison dans quelque chose, parce qu’il n’a pas ce qu’il lui faudrait pour être productif, parce que la fatalité des circonstances le réduit à ce point ; un tel ne sait pas toujours lui-même ce qu’il pourrait faire, mais il sent par instinct : pourtant je suis bon à quelque chose, je me sens une raison d’être ! Je sais que je pourrais être un tout autre homme ! À quoi donc pourrais-je être utile, à quoi pourrais-je servir ! Il y a quelque chose au-dedans de moi, qu’est ce que c’est donc ?
Cela est un tout autre fainéant, tu peux si tu juges bien, me prendre pour un tel !
Un oiseau en cage au printemps sait fortement bien qu’il y a quelque chose à quoi il serait bon, il sent fortement bien qu’il y a quelque chose à faire, mais il ne peut le faire, qu’est-ce que c’est ? il ne se le rappelle pas bien, puis il a des idées vagues, et se dit : « Les autres font leurs nids et font leurs petits et élèvent la couvée », puis il se cogne le crâne contre les barreaux de la cage. Et puis la cage reste là et l’oiseau est fou de douleur.
« Voilà un fainéant », dit un autre oiseau qui passe, celui-là c’est une espèce de rentier. (…)
**
Un Extrait page 276
(Année 1883)
Je vis donc comme un ignorant, qui sait une seule chose avec certitude : je dois achever en quelques années une tâche déterminée ; point n’est besoin de me dépêcher outre mesure, car cela ne mène à rien, je dois me tenir à mon travail avec calme et sérénité, aussi régulièrement et aussi ardemment que possible ; le monde ne m’importe guère, si ce n’est que j’ai une dette envers lui, et aussi l’obligation, parce que j’y ai déambulé pendant trente années, de lui laisser par gratitude quelques souvenirs sous la forme de dessins ou de tableaux qui n’ont pas été entrepris pour plaire à l’une ou l’autre tendance, mais pour exprimer un sentiment humain sincère.
Donc mon œuvre constitue mon unique but – si je concentre tous mes efforts sur cette pensée, tout ce que je ferai ou ne ferai pas deviendra simple et facile, dans la mesure où ma vie ne ressemblera pas à un chaos et où tous mes actes tendront vers ce but. Pour le moment, mon travail avance lentement – raison de plus de ne pas perdre de temps.
*
Un Extrait page 411
(Année 1888)
(…)mon idée serait qu’au bout du compte on eusse fondé et laisserait à la postérité un atelier où pourrait vivre un successeur. Je ne sais pas si je m’exprime assez clairement, mais en d’autres termes nous travaillons à un art, à des affaires, qui resteront non seulement de notre temps, mais qui pourront encore après nous, être continués par les autres.
Toi, tu fais cela dans ton commerce, c’est incontestable que dans la suite cela prendra, alors même qu’actuellement tu as beaucoup de contrariétés. Mais pour moi je prévois que d’autres artistes voudront voir la couleur sous un soleil plus fort et dans une limpidité plus japonaise.
Or si moi je fonde un atelier abri à l’entrée même du Midi, cela n’est pas si bête. Et justement cela fait que nous pouvons travailler sereinement. Ah ! si les autres disent c’est trop loin de Paris, etc., laissez faire, c’est tant pis pour eux. Pourquoi le plus grand coloriste de tous Eugène Delacroix a-t-il jugé indispensable d’aller dans le Midi et jusqu’en Afrique ? Évidemment puisque et non seulement en Afrique, mais même à partir d’Arles, vous trouverez naturellement les belles oppositions des rouges et des verts, des bleus et des oranges, du soufre et du lilas.
Et tous les vrais coloristes devront en venir là, à admettre qu’il existe une autre coloration que celle du Nord. Et je n’en doute pas si Gauguin venait, il aimerait ce pays-ci ; si Gauguin ne venait pas, c’est qu’il a déjà cette expérience des pays plus colorés, et il serait toujours de nos amis et d’accord en principe.
*
Un Extrait page 464
(janvier 1889)
Moi, avec ce petit pays-ci, j’ai pas besoin d’aller aux tropiques, du tout. Je crois et croirai toujours à l’art à créer aux tropiques et je crois qu’il sera merveilleux, mais enfin personnellement je suis trop vieux et (surtout si je me faisais remettre une oreille en papier mâché) trop en carton pour y aller.
Gauguin le fera-t-il ? Ce n’est pas nécessaire. Car si cela doit se faire cela se fera tout seul.
Nous ne sommes que des anneaux dans la chaîne.
Ce bon Gauguin et moi au fond du cœur nous comprenons, et si nous sommes un peu fous, que soit, ne sommes-nous pas un peu assez profondément artistes aussi, pour contrecarrer les inquiétudes à cet égard par ce que nous disons du pinceau.
Tout le monde aura peut-être un jour la névrose, le horla, la danse de Saint-Guy ou autre chose.
Mais le contrepoison n’existe-t-il pas ? dans Delacroix, dans Berlioz et Wagner? Et vrai notre folie artistique à nous autres tous, je ne dis pas que surtout moi je n’en sois pas atteint jusqu’à la moelle, mais je dis et maintiendrai que nos contrepoisons et consolations peuvent avec un peu de bonne volonté être considérés comme amplement prévalents.
**