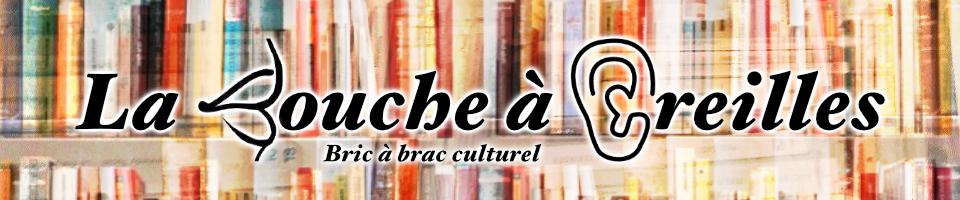Ce livre m’a été très gentiment offert l’année dernière par Ana-Cristina et, comme je l’ai beaucoup apprécié, je l’ai relu une seconde fois cette année car il rentre parfaitement dans le cadre du Printemps des Artistes.
Effectivement, ce petit livre de Virginia Woolf nous propose quatre portraits de grands écrivains américains : Henry David Thoreau, Herman Melville, le poète Walt Whitman et « l’Helen de Poe », c’est-à-dire la poétesse américaine Sarah Helen Power Whitman (1803-1878) qui fut une égérie d’Edgar Allan Poe.
Note Pratique sur le livre
Editeur : La Part commune
Dates de parutions initiales : 1917 et 1919
Traduit, présenté et annoté par Cécile A. Holdban
Nombre de pages : 61
Quatrième de Couverture
Quand la grande romancière anglaise se propose de rendre visite à quatre des plus grands noms de la littérature américaine du dix-neuvième siècle, le lecteur est assuré d’un dépaysement enthousiasmant. En effet, sans s’éloigner des grandes lignes de leurs vies et de leurs œuvres, Virginia Woolf n’en dresse pas moins un portrait personnel, curieux, malicieux, et forcément hors des sentiers battus.
Mon Avis
J’avais déjà eu l’occasion d’admirer la plume raffinée et l’intelligence aiguisée de Virginia Woolf dans son roman « Les vagues » et dans son essai « Une chambre à soi » mais, dans ce livre-ci, j’ai pu découvrir également son sens de la psychologie et un esprit critique extrêmement pénétrant. Concernant le dernier chapitre, sur Edgar Poe (1809-1849), elle fait preuve d’une ironie et d’une causticité vraiment réjouissantes et c’est rafraîchissant de la voir si irrévérencieuse avec un écrivain universellement admiré et hautement respecté. Elle n’hésite pas à le traiter de « serpent irrécupérable » et à qualifier ses lettres d’amour d’ennuyeuses.
A contrario, le chapitre consacré à Thoreau (1817-1862) – le plus développé des quatre – témoigne d’une admiration très forte et sans restriction. Sa compréhension de Thoreau semble très profonde, marquée par l’empathie. À aucun moment elle ne porte de jugement sur son « égoïsme » (c’est elle qui emploie ce mot) et, bien au contraire, elle voit cette attitude individualiste comme une sorte d’élévation spirituelle et morale. Elle nous parle de l’influence du Transcendantalisme sur Thoreau. Elle évoque son amour de la nature plutôt que celui de la société humaine – les deux étant probablement antagonistes, selon lui.
Le chapitre sur Walt Whitman (1819-1892) – le plus court et le plus lyrique des quatre – nous montre la grande sympathie de Virginia Woolf pour l’auteur de « Feuilles d’herbe« . Elle en fait un portrait très flatteur en nous le présentant comme un homme simple, chaleureux et accessible, qui se contentait d’un mode de vie très fruste. Elle nous parle aussi des jugements de Whitman sur certains hommes de lettres de son temps.
Dans le chapitre sur Melville (1819-1891) elle se concentre sur ses deux premiers romans, qui ne sont pas les plus connus et dont je n’avais pas entendu parler : « Taïpi » (1846) et « Omoo » (1847). Ces deux romans se déroulent dans les îles Marquises, auprès des populations autochtones, et inspirent à Virginia Woolf de belles réflexions sur le bonheur – l’idée, en particulier, qu’une existence continuellement heureuse ne pourrait pas être satisfaisante.
Un livre vraiment intéressant, riche en belles réflexions, qui nous renseigne non seulement sur ces quatre figures majeures de la littérature américaine mais aussi sur la personnalité complexe et la grande exigence – littéraire et morale, me semble-t-il – de Virginia Woolf.
**
Un Extrait page 23
(Sur Henry David Thoreau)
(…) Force est de dire que peu de gens s’intéressent à eux-mêmes autant que Thoreau s’intéressa à lui-même, car si nous sommes doués d’un intense égoïsme, nous faisons de notre mieux pour l’étouffer afin de vivre en bons termes avec nos voisins. Nous ne sommes pas assez sûrs de nous-mêmes pour briser complètement l’ordre établi. Telle fut l’aventure de Thoreau ; ses livres sont le récit de cette expérience et de ses résultats. Il a fait tout ce qu’il a pu pour augmenter sa compréhension de lui-même, pour encourager tout ce qui était particulier en lui, pour se soustraire au contact de toute force susceptible d’interférer avec ce don extrêmement précieux de la personnalité. C’était son devoir sacré, non pas envers lui seul mais envers le monde, et un homme n’est guère égoïste s’il est égoïste à une si grande échelle. En lisant Walden, récit de ses deux années passées dans les bois, nous avons le sentiment de voir la vie à travers une loupe très puissante. Marcher, manger, débiter des bûches, lire un peu, observer l’oiseau sur la branche, se préparer son repas : toutes ces occupations, quand elles sont raclées, nettoyées et ressenties à neuf, s’avèrent merveilleusement vastes et brillantes. (…)
*
Un Extrait page 60
(Sur Edgar Poe)
(…) Aussi cynique que cela paraisse, nous doutons que Mrs. Whitman ait perdu autant que ce qu’elle a gagné avec la fin malheureuse de son histoire d’amour. Ses sentiments pour Poe étaient probablement davantage ceux d’une bienfaitrice que d’une amante car elle était de ces personnes qui « croient pieusement que les serpents peuvent s’amender. On ne peut y parvenir qu’à force de patience et de prière – mais les résultats sont merveilleux ».
Ce serpent-là était irrécupérable ; on le ramassa, inconscient, dans la rue, et il mourut un an plus tard. Mais il a laissé derrière lui une moisson de reptiles qui mirent à rude épreuve la patience de Mrs. Whitman et eurent besoin de ses prières jusqu’à sa mort. Elle devint l’autorité reconnue sur Poe, et chaque fois qu’un biographe avait besoin d’informations ou que la vieille Mrs. Clemm avait besoin d’argent, ils s’adressaient à elle. Elle devait régler les discordes entre les différentes dames qui affirmaient avoir été la plus aimée, et maintenir la paix entre les historiens rivaux, car on n’a pas encore tranché pour savoir si une femme est plus vaniteuse en amour qu’un auteur l’est de son œuvre. (…)
**