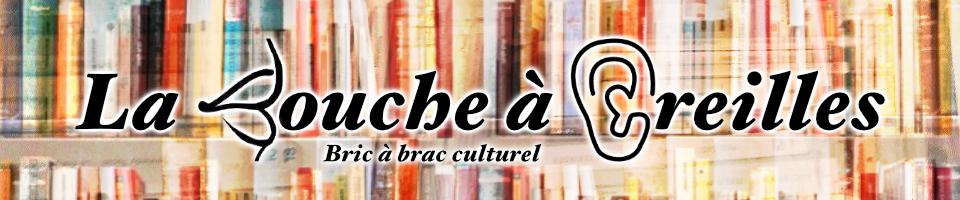J’ai déjà chroniqué sur ce blog un grand nombre de romans d’Annie Ernaux et il était temps que je m’attaque à son tout premier livre, publié chez Gallimard en 1973, Les Armoires vides (référence à un poème d’Eluard qu’elle cite en exergue).
Dans ce roman, on trouve en germe un certain nombre des thèmes chers à l’écrivaine et qu’elle détaillera dans ses ouvrages suivants : l’avortement qu’elle a subi lorsqu’elle était étudiante, la honte du milieu social de ses parents, le désir d’ascension sociale allant de pair avec l’amour des livres et de la littérature, le conformisme de sa mère, etc.
Bien que l’autrice ait choisi le prénom de Denise pour désigner son héroïne, ainsi que des noms de lieux factices, adoptant la forme d’une fiction, nous lisons à travers ces lignes un roman autobiographique et reconnaissons parfaitement le désir d’Annie Ernaux de rendre compte de sa propre réalité par l’écriture.
Cependant le style de l’écrivaine est très différent dans ce premier roman de ce qu’il sera plus tard, neutre et épuré, dans La Place ou dans Mémoire de Fille. On trouve en effet dans les Armoires vides un mélange d’argot, de langage populaire ou trivial, et de langage plus soutenu, qui convoquent les deux milieux sociaux auxquels elle se réfère : celui des parents et celui de l’école privée chrétienne où ils l’ont mise – deux mondes socialement opposés, ressentis comme inconciliables.
Dans ce roman-ci elle essaye aussi très fréquemment de susciter le dégoût du lecteur par des évocations d’odeurs, de couleurs, de détails sordides sur lesquels elle insiste beaucoup.
Pour ma part, j’ai été étonnée et mal à l’aise devant la haine et la rancœur étalées tout le long du livre contre à peu près tout le monde, les pauvres, les riches, les commerçants, les notables, ses parents, ses camarades d’école, ses professeurs, ses flirts et ses amants, ceux qui n’ont pas de culture et ceux qui en ont …
J’ai été étonnée aussi que certaines choses soient considérées par l’autrice comme typiquement prolo (l’avortement, le désir sexuel, l’alcoolisme, l’absence de pudeur, de distinction et de culture, etc.) comme si les bourgeois et les riches étaient tous des petits saints, sans vie sexuelle, qui n’avortaient pas, ne buvaient pas, passaient leur vie à se cultiver et étaient tous très distingués …
Un livre qui ne m’a plu que très moyennement, mais qui est intéressant par l’éclairage insolite qu’il apporte sur l’oeuvre ultérieure de cette écrivaine et, peut-être, sur ses sentiments profonds.
**