Ces textes sont issus du livre Pour qui, pour quoi travaillons-nous ? et ont été écrits dans les années 80, puis republiés chez La Table Ronde en 2013.
Jacques Ellul (1912-1994) est un historien, sociologue et théologien protestant libertaire français. Il a parfois été qualifié d’anarchiste chrétien.
Pages 72 à 74 :
(…)Les textes de Voltaire, l’un des créateurs de l’idéologie du travail, sont tout à fait éclairants à ce sujet : » le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice et le besoin » ou encore « Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens ». Et ce n’est pas pour rien que ce soit Voltaire justement qui mette au premier plan la vertu du travail. Car celui-ci devient vertu justificatrice. On peut commettre beaucoup de fautes de tous ordres, mais si on est un ferme travailleur on est pardonné. Un pas de plus, et nous arrivons à l’affirmation, qui n’est pas moderne, que « le travail c’est la liberté ». Cette formule rend aujourd’hui un son tragique parce que nous nous rappelons la formule à l’entrée des camps hitlériens « Arbeit macht frei ». Mais au XIXe siècle on expliquait gravement qu’en effet seul le travailleur est libre, par opposition au nomade qui dépend des circonstances, et au mendiant qui dépend de la bonne volonté des autres.
Le travailleur, lui, chacun le sait, ne dépend de personne. Que de son travail ! Ainsi l’esclavage du travail est mué en garantie de liberté.
Et de cette morale nous trouvons deux applications plus modernes : l’Occidental a vu dans sa capacité à travailler la justification en même temps que l’explication de sa supériorité à l’égard de tous les peuples du monde. Les Africains étaient des paresseux. C’était un devoir moral que de leur apprendre à travailler, et c’était une légitimation de la conquête. On ne pouvait pas entrer dans la perspective que l’on s’arrête de travailler quand on a assez pour manger deux ou trois jours. Les conflits entre employeurs occidentaux et ouvriers arabes ou africains entre 1900 et 1940 ont été innombrables sur ce thème-là. Mais, très remarquablement, cette valorisation de l’homme par le travail a été adoptée par des mouvements féministes. L’homme a maintenu la femme en infériorité, parce que seul il effectuait le travail socialement reconnu. La femme n’est valorisée aujourd’hui que si elle « travaille » : compte tenu que le fait de tenir le ménage, élever les enfants n’est pas du travail, car ce n’est pas du travail productif et rapportant de l’argent. Gisèle Halimi dit par exemple : « La grande injustice c’est que la femme a été écartée de la vie professionnelle par l’homme. » C’est cette exclusion qui empêche la femme d’accéder à l’humanité complète.
(…)Le travail est ainsi identifié à toute la morale et prend la place de toutes les autres valeurs. Il est porteur de l’avenir. Celui-ci, qu’il s’agisse de l’avenir individuel ou de celui de la collectivité, repose sur l’effectivité, la généralité du travail. Et à l’école, on apprend d’abord et avant tout à l’enfant la valeur sacrée du travail. C’est la base (avec la Patrie) de l’enseignement primaire de 1860 à 1940 environ. Cette idéologie va pénétrer totalement des générations.
Et ceci conduit à deux conséquences bien visibles, parmi d’autres. Tout d’abord, nous sommes dans une société qui a mis progressivement tout le monde au travail. Le rentier, comme auparavant le Noble ou le Moine, tous deux des oisifs, devient un personnage ignoble vers la fin du XIXe siècle. Seul le travailleur est digne du nom d’homme. Et à l’école on met l’enfant au travail comme jamais dans aucune civilisation on n’a fait travailler les enfants (je ne parle pas de l’atroce travail industriel ou minier des enfants au XIXe siècle, qui était accidentel et lié non pas à la valeur du travail mais au système capitaliste). Et l’autre conséquence actuellement sensible : on ne voit pas ce que serait la vie d’un homme qui ne travaillerait pas. Le chômeur, même s’il recevait une indemnité suffisante, reste désaxé et comme déshonoré par l’absence d’activité sociale rétribuée. Le loisir trop prolongé est troublant, assorti de mauvaise conscience. Et il faut encore penser aux nombreux « drames de la retraite ». Le retraité se sent frustré du principal. Sa vie n’a plus de productivité, de légitimation : il ne sert plus à rien. C’est un sentiment très répandu qui provient uniquement du fait que l’idéologie a convaincu l’homme que la seule utilisation normale de la vie était le travail.
***
JACQUES ELLUL
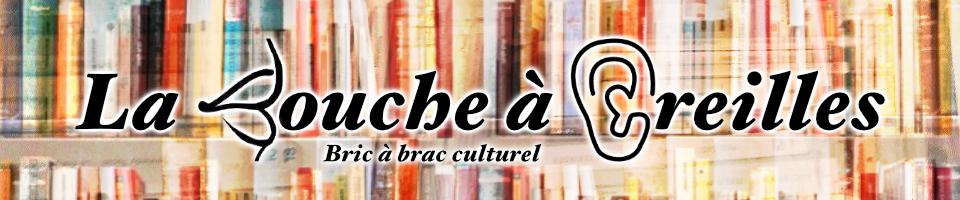

Très intéressant…
Merci Goran 🙂
‘Knulp’, de Hermann Hesse, est un roman magnifique sur le même sujet.
Merci de cette référence. Je vais tâcher de me le procurer.
J’aime beaucoup Jacques Ellul ; et si ce texte était une pétition de principe, je le signerais !… Encore qu’il faudrait y ajouter cette opposition essentielle entre travail-production et travail-passion… Seul ce dernier (dans le cas malheureusement courant où il ne recoupe pas sa profession) permet l’épanouissement, si du moins il permet aussi d’assouvir le besoin de socialité qui caractérise cet animal social qu’est l’homme…
Merci, Marie-Anne, pour ce texte !
Tout à fait ! Il parle ici du travail comme gagne-pain obligatoire et pas des tâches agréables que nous choisissons librement. Il considère que le travail-production est un asservissement, un genre de corvée, qui ne mérite pas d’être considéré comme une valeur morale ou politique … moi aussi je suis d’accord avec cette idée 🙂 Merci Michel !
Intéressant, merci Marie-Anne !
Et bonne journée.
Bonne journée Jean-Louis 🙂 Merci de ta visite !
On ne peut qu’être d’accord avec un « anarchiste chrétien » ! Cependant, comme Michel, je crois qu’il y a un grand malentendu sur la notion de « travail ». Moi qui consacre aujourd’hui une bonne partie de mon temps et de mon énergie à créer un jardin, je m’étonne toujours des remarques de visiteurs qui n’y voient que le « travail » que cela représente. Comme si nous étions des esclaves volontaires. De considérer ainsi tout effort, physique ou intellectuel, comme un travail aliénant discrédite à mes yeux toute critique du travail.
Encore merci pour ce texte qui porte à réfléchir, y compris sur certains discours féministes !
Danielle
Bonjour Danielle ! Merci de votre commentaire. Dans le livre, Ellul parle du travail en tant que gagne-pain, profession choisie par nécessité de subvenir à ses besoins. Il voudrait justement réduire la part de ces corvées pour nous donner plus de temps pour le travail-passion et pour nos « vocations » (artistiques, spirituelles, etc.). Ce qu’il critique c’est notre société qui a élevé le travail (gagne-pain) au rang de valeur morale et politique.
Belle idée de créer un jardin – ça doit être passionnant quand on aime – et très agréable de le voir pousser au gré des saisons …
Amitiés, Marie-Anne
Bonsoir Marie-Anne,
j’entends bien ce qu’Ellul critique mais la vieille réac’ que je suis constate qu’à force d’assimiler le « travail gagne-pain » à une corvée, on en finit par assimiler tout effort à une corvée. Et à ne concevoir le bonheur que comme du farniente. Ce qui fait le jeu de tous les marchands de loisirs faciles et imbéciles… Bien amicalement, danielle
Eh bien tout dépend de quel genre de gagne-pain on a. Certains métiers sont très astreignants, très répétitifs, ou ennuyeux ou pénibles, d’autres vous réduisent l’espérance de vie d’une trentaine d’années … Et Ellul n’assimile pas tout effort à une corvée, loin de là, puisqu’il fait l’éloge du travail-vocation ou de l’altruisme ou de l’engagement politique et spirituel. Par ailleurs, il dénonce précisément ce que vous appelez les loisirs faciles et imbéciles. Vous devriez lire son livre, vous verriez qu’il n’est pas si bête et caricatural que vous l’imaginez.
Chère Marie-Anne, nous nous sommes très mal comprises ! Ou je me suis très mal exprimée. J’ai une très haute estime pour Jacques Ellul !!! J’en ai beaucoup moins pour ceux qui se réfèrent à sa pensée pour dénigrer tout sens de l’effort. Autant je suis écoeurée par les conditions de travail imposées dans les centres d’appel ou dans les plates-formes d’Amazon (entre autres horreurs du salariat moderne), autant je reste convaincue que l’être humain ne peut s’épanouir sans se confronter à des épreuves, sans s’imposer des défis qui demandent des efforts, parfois de la souffrance comme s’en imposent les sportifs. J’espère que ce malentendu n’interrompra pas notre dialogue. Bien amicalement, danielle
D’accord, je comprends votre point de vue. Le goût de l’effort est tout à fait louable et nous aide à nous dépasser … quant à la souffrance je me permets de ne pas courir après et je crois que chacun en a un lot suffisant dans la vie … Bonne journée ! Marie-Anne
Oui, tout est question de mesure ! Je suis en train de lire les belles citations de Christian Bobin que vous avez sélectionnées sur le thème de la lecture. Il apporte de l’eau à mon moulin pour effacer toute ambiguïté : « Lire. Déplier l’échelle qui est dans l’âme, dont les degrés se perdent, vers le haut comme vers le bas. » Merci et beau dimanche, Danielle
C’est drôle que vous parliez de Christian Bobin, je suis justement en train de lire son très beau livre sur Emily Dickinson « la dame blanche ». Merci à vous et beau dimanche ! Amicalement, Marie-Anne
Dès qu’on peut à nouveau entrer dans une bibliothèque ou une librairie, je vais me le procurer ! Belle lecture ! Danielle
Moi aussi je guette la réouverture des librairies 🙂 Bonne journée !
Oui, il y a urgence ! Et après les librairies, les jardins (plus ou moins) remarquables. Belles lectures ! danielle
Oups… Encore faudrait-il et non « encore qu’il faudrait » !… Même pas le subjonctif après « encore que » !… Pardon à la langue française ! 🙂
Pas de souci 🙂
Intéressant point de vue. Merci Marie-Anne pour cet éclairage.
Merci Prince 🙂