J’ai déjà chroniqué sur ce blog un grand nombre de romans d’Annie Ernaux et il était temps que je m’attaque à son tout premier livre, publié chez Gallimard en 1973, Les Armoires vides (référence à un poème d’Eluard qu’elle cite en exergue).
Dans ce roman, on trouve en germe un certain nombre des thèmes chers à l’écrivaine et qu’elle détaillera dans ses ouvrages suivants : l’avortement qu’elle a subi lorsqu’elle était étudiante, la honte du milieu social de ses parents, le désir d’ascension sociale allant de pair avec l’amour des livres et de la littérature, le conformisme de sa mère, etc.
Bien que l’autrice ait choisi le prénom de Denise pour désigner son héroïne, ainsi que des noms de lieux factices, adoptant la forme d’une fiction, nous lisons à travers ces lignes un roman autobiographique et reconnaissons parfaitement le désir d’Annie Ernaux de rendre compte de sa propre réalité par l’écriture.
Cependant le style de l’écrivaine est très différent dans ce premier roman de ce qu’il sera plus tard, neutre et épuré, dans La Place ou dans Mémoire de Fille. On trouve en effet dans les Armoires vides un mélange d’argot, de langage populaire ou trivial, et de langage plus soutenu, qui convoquent les deux milieux sociaux auxquels elle se réfère : celui des parents et celui de l’école privée chrétienne où ils l’ont mise – deux mondes socialement opposés, ressentis comme inconciliables.
Dans ce roman-ci elle essaye aussi très fréquemment de susciter le dégoût du lecteur par des évocations d’odeurs, de couleurs, de détails sordides sur lesquels elle insiste beaucoup.
Pour ma part, j’ai été étonnée et mal à l’aise devant la haine et la rancœur étalées tout le long du livre contre à peu près tout le monde, les pauvres, les riches, les commerçants, les notables, ses parents, ses camarades d’école, ses professeurs, ses flirts et ses amants, ceux qui n’ont pas de culture et ceux qui en ont …
J’ai été étonnée aussi que certaines choses soient considérées par l’autrice comme typiquement prolo (l’avortement, le désir sexuel, l’alcoolisme, l’absence de pudeur, de distinction et de culture, etc.) comme si les bourgeois et les riches étaient tous des petits saints, sans vie sexuelle, qui n’avortaient pas, ne buvaient pas, passaient leur vie à se cultiver et étaient tous très distingués …
Un livre qui ne m’a plu que très moyennement, mais qui est intéressant par l’éclairage insolite qu’il apporte sur l’oeuvre ultérieure de cette écrivaine et, peut-être, sur ses sentiments profonds.
**
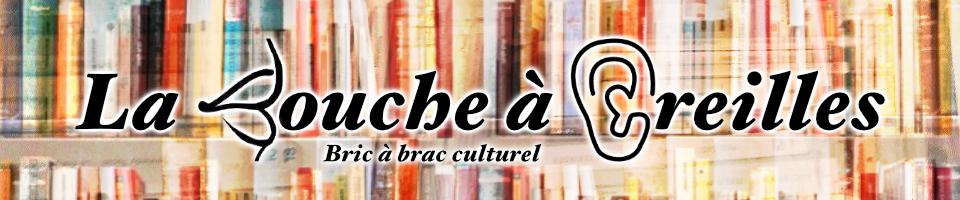

Je vais commencer par « Les années ». En gros, je vais suivre ton conseil 🙂
J’espère que ce sera un bon conseil ! « La femme gelée » est aussi très bien…
Je notes ça, merci:-)
Merci bcp pour ce retour. Je ne le connaissais pas !
J’étais étonnée par le ton de ce premier roman, très expressif ! Clairement, son style a beaucoup changé par la suite, et je préfère nettement ses périodes plus « mûres ».
Merci Matatoune 🙂
Je n’ai lu d’elle que « Une femme » et elle ne m’a pas donné envie de poursuivre l’aventure…
J’avais plutôt bien aimé « Une femme »… un portrait assez complexe de sa mère, si je me souviens bien.
Le côté sociologique et autobiographique de ses livres ne plait pas à tout le monde…
Ce n’est pas le côté sociologique et autobiographique qui me déplaît (mes lectures sont très souvent des autobiographies…) mais son écriture où j’avais ressenti une certaine aigreur, amertume…
Oui, je comprends, je suis de votre avis pour quelques uns de ses livres…
Bonjour Marie-Anne, je ne l’ai pas lu ainsi de mon coté…Je n’y ai pas senti de haine ni d’envie de susciter un dégoût à tout prix, seulement une réalité compacte de ce milieu dont elle dirait l’absence de rancœur qu’elle a à son égard dans tout le reste de son oeuvre…
Sans doute, au fur et à mesure des années, elle a pris le recul nécessaire pour parler de son milieu d’origine sans ressentiment, et son écriture est devenue plus neutre, plus retenue.
Mais dans ce premier roman il y a bien peu de personnages sympathiques ou qui puissent lui servir de modèle pour grandir…
D’ailleurs, elle a souvent évoqué sa « honte » de son milieu d’origine (c’est même le titre de l’un de ses livres) tout en parlant aussi de sa culpabilité de les avoir trahis en passant dans la classe sociale supérieure…
Surprenant premier livre que je ne connaissais pas… Il faut que je remonte dans le temps de cette auteure dont j’ai apprécié la plupart des livres !
Moi aussi j’apprécie beaucoup Annie Ernaux ! Ce livre-ci, son premier roman, m’a paru tout de même très différent des livres ultérieurs. On sent qu’elle n’a pas encore pris tout le recul qu’elle aura ensuite…
Vous parlez de deux mondes socialement opposés, ressentis comme inconciliables pour Annie Ernaux. Je pense que cet auteur -dont je connais bien les origines, mes parents étant de la même génération, même tranche de la société (approche politique différente néanmoins) et même zone géographique- aborhe (orthographe? 🙂) surtout ses racines provinciales.
Merci de votre article en lequel j’ai reconnu nombre de mes idées sur cette native d’Yvetot, partie haute et plate (😉) de la Seine maritime si attrayante par ailleurs.
Racines provinciales, sans doute, mais surtout origines modestes, petits commerçants et ouvriers. On peut être à la fois provincial et très bourgeois, comme elle le décrit très bien à travers ses camarades de classe d’une école privée catholique.
Merci de votre commentaire ! Bonne journée
Ce n’est pas par celui-ci que je débuterais donc car il me reste à découvrir l’œuvre d’Annie Ernaux. Je te rejoins totalement sur cette idée que les classes supérieures ont les mêmes « errements » que les autres. Excellente soirée Marie-Anne 🙂
Oui, les classes supérieures ont aussi leurs violences, leur grossièreté ou leur bêtise, et les classes dites « inférieures » sont capables de grande finesse et intelligence… c’est du moins ce que je ressens ! Bonne soirée Frédéric 🙂
Je partage tes impressions de lecture, Marie-Anne. Après plusieurs années, il me reste le souvenir d’une oeuvre intéressante d’un point de vue sociologique. Mais tellement déprimante… Belle journée, Daniellle
Oui, c’est vrai, son œuvre ne respire pas la joie de vivre… Elle a un regard pas très tendre sur le monde qui l’entoure, sans doute par un excès de lucidité…
J’ai des livres d’Annie Ernaux… Il faudrait que je me lance un jour!
C’est une écrivaine intéressante ! J’ai aimé la plupart des livres que j’ai lus d’elle…
j’ai souvent pensé qu’il y avait une étrange parenté entre ernaux et houellebecq, comme si on pouvait prélever un passage de l’un et l’insérer dans un livre de l’autre sans que cela se remarque. c’est peut-être le côté sociologique, et puis l’aigreur , l’amertume communes aux 2 auteurs, par ailleurs très différents puisque ernaux est féministe alors que houellebecq est clairement mysogine…
Oui Denis je suis d’accord avec toi. Ernaux et Houellebecq ont en commun une lucidité un peu aigre et désespérée. Ils aiment décrire les aspects désagréables de la vie. Mais leurs bords politiques sont tout à fait opposés…