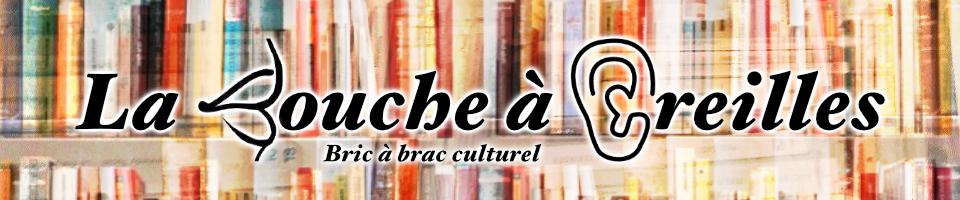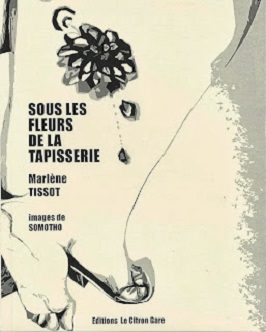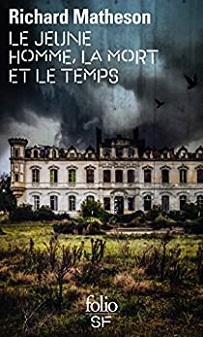Je possède ce livre depuis de très nombreuses années, lu autour de 20-25 ans et dormant dans ma bibliothèque depuis tout ce temps. J’ai donc décidé de le relire ces jours-ci pour le défi des Feuilles allemandes organisé par Patrice et Eva du blog « Et si on bouquinait un peu » et par Fabienne, animatrice de « Livrescapades« .
Note biographique sur le poète
Hugo von Hofmannsthal (né en 1874 à Vienne et mort en 1929 à Rodaun) est un écrivain, dramaturge, essayiste, poète et librettiste autrichien. Il est considéré comme l’un des principaux représentants du « Modernisme viennois ». Issu d’une noble famille, en partie juive du côté paternel, il écrit ses premiers poèmes à seize ans. Il fait des études de droit et de langues romanes. Il est influencé par les écrits de Freud et par ceux de Nietzsche. Il publie en 1902 La Lettre de Lord Chandos, qui préfigure les romans existentialistes futurs. Il rencontre en 1906 le compositeur Richard Strauss, avec qui il va collaborer sur plusieurs livrets d’opéra : Le Chevalier à la rose en 1911, Ariane à Naxos (1912), La Femme sans ombre (1919), Hélène d’Egypte (1927) et Arabella en 1929.
Avec l’aide de Max Reinhardt, Hofmannsthal crée le désormais célèbre festival de Salzbourg, en 1920.
Hugo von Hofmannsthal meurt d’une crise cardiaque durant l’enterrement de son fils cadet, Franz, qui s’était suicidé deux jours plus tôt.
(Source : Wikipédia, résumé par mes soins)
Note Pratique sur le livre
Titre : Avant le jour
Éditeur : Orphée La Différence
Première date de publication en allemand : 1924
Date de publication de cette traduction : 1990
Traduction par Jean-Yves Masson
Nombre de pages : 189
Quatrième de Couverture
Hugo von Hofmannsthal (1874-1929). Sa poésie est encore en France la part la plus méconnue d’une œuvre aussi diverse que brillante, alors qu’elle offre (ce qui reste rare) un contre-chant parallèle aux drames lyriques comme aux livres d’interrogation. Hofmannsthal sait capter les derniers feux de Vienne, pressentir les secrets du rêve, et dresser un autre théâtre, plus ambigu, dont il orchestre merveilleusement les reflets et les échos. Poète majeur, il relie le romantisme à l’introspection, et fonde la modernité sur l’apport inépuisable de la tradition. Choix, traductions et présentation par Jean-Yves Masson.
**
Pages 33-35
Tercets
I
Sur la fugacité des choses
Je sens encore leur souffle sur mes joues :
Comment cela se peut-il, que ces jours proches
Se soient enfuis, et pour toujours enfuis, passés à jamais ?
C’est là chose que nul ne conçoit tout à fait
Bien trop affreuse pour que l’on songe seulement à déplorer
Que tout s’écoule et se précipite au néant
Et que mon propre Moi, sans trouver nul obstacle,
Ait glissé jusqu’à moi depuis le corps d’un jeune enfant
Et me soit comme un chien inquiétant, étranger et muet.
Et puis : que j’aie vécu il y a cent ans aussi,
Et que mes ancêtres, qui sont dans leur linceul,
Me soient autant liés que mes propres cheveux
Et avec moi soient un, autant que mes propres cheveux
Il
Ô ces heures ! où sur la clarté bleue de la mer,
Nous fixons nos regards et comprenons la mort,
D’un cœur si léger et solennel, et sans effroi :
Comme de petites filles, qui paraissent très pâles,
Avec de grands yeux, et qui toujours ont froid,
Regardent par un soir devant elles en silence
Et savent qu’à présent la vie coule doucement
De leurs membres ivres de sommeil, jusque
Dans l’herbe et les arbres, – et, pudiques, sourient faiblement
Comme une sainte qui verse son sang.
III
Nous sommes de la même étoffe que les songes,
Et les songes ouvrent leurs yeux, pareils
À de petits enfants sous des cerisiers
De la cime desquels la course d’or pâle
De la pleine lune s’élève à travers la vaste nuit
…. Ce n’est pas autrement que surgissent nos songes.
Les voici, ils sont vivants comme un enfant qui rit,
Aussi grands, qu’ils montent ou descendent dans l’air,
Que la pleine lune qui s’éveille à la cime des arbres.
Le plus intime de nous-même est livré au va-et-vient
De leurs mains de spectres qui tissent dans l’espace encombré.
Ils sont en nous, et ils ont vie à tout jamais.
Et trois font un : un homme, une chose, un songe.
**