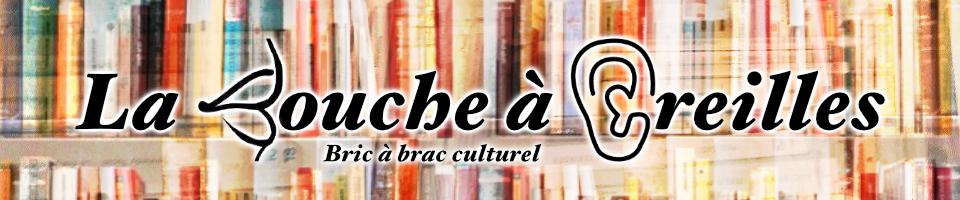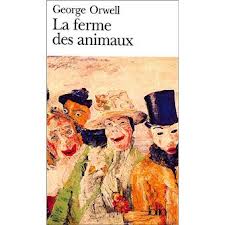Dans le cadre de mon Printemps des Artistes de 2022, je vous propose ce roman de Kundera dont le personnage principal est un jeune poète tchèque, prénommé Jaromil, et qui nous est présenté comme un homme tout à fait odieux, narcissique, imbu de lui-même, arriviste et immoral.
Note pratique sur le livre
Première date de parution : (en Tchéquie) 1969 (en France) 1973.
Editeur : Folio
Nombre de pages : 463
Prix Médicis étranger 1973
Quatrième de Couverture
L’auteur avait tout d’abord pensé intituler ce roman L’âge lyrique. L’âge lyrique, selon Kundera, c’est la jeunesse, et ce roman est avant tout une épopée de l’adolescence ; épopée ironique qui corrode tendrement les valeurs tabous : l’Enfance, la Maternité, la Révolution et même – la Poésie. En effet, Jaromil est poète. C’est sa mère qui l’a fait poète et qui l’accompagne (immatériellement) jusqu’à ses lits d’amour et (matériellement) jusqu’à son lit de mort. Personnage ridicule et touchant, horrible et d’une innocence totale («l’innocence avec son sourire sanglant» !), Jaromil est en même temps un vrai poète. Il n’est pas salaud, il est Rimbaud. Rimbaud pris au piège de la révolution communiste, pris au piège d’une farce noire.
Mon avis très subjectif
On sent à travers ce roman que Milan Kundera a une très grande connaissance de la psychanalyse car son personnage de poète narcissique, Jaromil, semble être un cas d’école, un archétype assez saisissant (mais tout de même caricatural, je pense) qui pourrait servir d’objet d’étude pour un psy, par son rapport fusionnel avec sa mère abusive, sa jalousie maladive et morbide envers les femmes, son imagination lyrique et révolutionnaire, son ambition démesurée et son arrivisme forcené, sans aucun scrupule… et ce sont donc tous ses traits de caractère qui sont détaillés et analysés les uns après les autres, comme des petites facettes qui s’agrègent les unes aux autres et vont en s’aggravant puisque le portrait est de plus en plus repoussant et ignoble.
Kundera nous explique clairement au cours du roman que le personnage de Jaromil lui a été fortement inspiré par les modèles de Rimbaud, de Lermontov, de Maïakovski, de Hugo, et de tous les grands poètes lyriques qui se sont mis, un jour ou l’autre, au service d’une révolution, du communisme (plus exactement, qui se sont compromis avec un pouvoir dictatorial) et qui ont essayé de mélanger le rêve et la réalité, l’idéal et le pragmatisme.
J’avais déjà vu dans son Art du roman que Kundera déteste le lyrisme, le romantisme, le sentiment (qu’il soit synonyme de sentimentalité ou d’engagement sérieux), aussi ses romans ont tendance à être toujours ironiques, désabusés, sceptiques et on retrouve dans La Vie est ailleurs cet esprit de dérision, d’incrédulité et de causticité. On est donc ici face à un écrivain qui n’aime pas ses personnages et qui les décortique cruellement, sans leur épargner le moindre ridicule ou la description de leur moindre bassesse.
Du côté des nombreux points positifs : c’est un roman extrêmement brillant, intelligent, remarquablement construit, très cultivé, très freudien. Mais il défend des points de vue sur la poésie parfois discutables…
Et je me suis demandé si un personnage vraiment aussi avide de pouvoir, d’autorité et de gloire que ce méchant Jaromil ne se tournerait pas vers la direction d’un parti politique ou d’une milice quelconque plutôt que vers une activité aussi infortunée et décriée que la poésie…
Peut-être aussi que la haine de l’écrivain envers ses personnages est trop criante et immodérée… et que, pour une fois, il aurait pu instiller un tout petit peu plus de sentiment et de compassion…
Un Extrait page 320
La poésie est un territoire où toute affirmation devient vérité. Le poète a dit hier : La vie est vaine comme un pleur, il dit aujourd’hui : la vie est gaie comme le rire et à chaque fois il a raison. Il dit aujourd’hui ; tout s’achève et sombre dans le silence, il dira demain : rien ne s’achève et tout résonne éternellement et les deux sont vrais. Le poète n’a besoin de rien prouver ; la seule preuve réside dans l’intensité de son émotion.
Le génie du lyrisme est le génie de l’inexpérience. Le poète sait peu de choses du monde mais les mots qui jaillissent de lui forment de beaux assemblages qui sont définitifs comme le cristal ; le poète n’est pas un homme mûr et pourtant ses vers ont la maturité d’une prophétie devant laquelle il reste lui-même interdit.
(…)
L’immaturité du poète prête sans doute à rire mais elle a aussi de quoi nous émerveiller : il y a dans les paroles du poète une gouttelette qui a surgi du cœur et qui donne à ses vers l’éclat de la beauté. Mais cette gouttelette, il n’est nullement besoin d’une véritable expérience vécue pour la tirer du cœur du poète, nous pensons plutôt que le poète presse parfois son cœur à la façon d’une cuisinière pressant un citron sur la salade. (…)