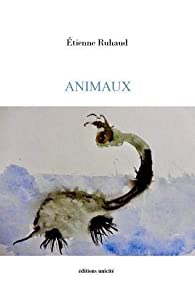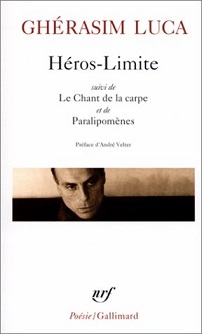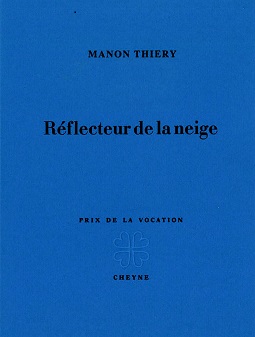J’avais déjà présenté sur ce blog le premier roman d’Etienne Ruhaud, Disparaître, publié chez Unicité, un livre de grande qualité. Je vous parlerai aujourd’hui de son recueil de proses poétiques « Animaux« , paru en 2020 chez ce même éditeur.
Quatrième de Couverture
..Mais l’important, plus qu’à ces sensations de cauchemars banals, tient à l’opération d’écriture. Laquelle présente un double trait. Il faut noter, en premier lieu, la précision du lexique, ou, plus exactement, sa littéralité. Étienne Ruhaud écarte la facilité métaphorique (laquelle, de surcroît, mène au vague, à l’indécision), et choisit les termes exacts : « leur corps mesure environ un mètre cinquante », « des oeufs bruns de la taille d’un ballon de basket », « une vaste galette spongieuse mais étanche, rainurée de tiges sanguines ». Ou bien : « bouche dentelée », « membrane cartilagineuse », « orifice noir », etc.
Et cette précision ― c’est le deuxième trait ― se trouve, elle-même, doublement accentuée. D’abord, par le vague des lieux, des espaces où ces animaux séjournent ou se rencontrent : « le continent », « l’océan », « l’archipel », « les volcans », « la ville », « la montagne » (l’article défini donnant à ce vague son étrange présence). Ensuite, par l’indistinction des figures humaines : hormis ce « je » qui fait irruption dans l’un des poèmes, on ne connaît que « les gens », « les habitants », « les tribus », « les indigènes », « les vieux », « les malades », « les pauvres » (notons la constance du pluriel, en quoi se dissout toute singularité).
(Extrait de la préface de Jean Renaud)
Mon Avis
On reconnaît dans ce livre l’attrait de l’auteur pour le Surréalisme, avec la prédominance des mondes imaginaires, du monstrueux – qui n’est jamais très loin du merveilleux – et, en lisant les descriptions de ces bêtes fabuleuses, nous pourrions facilement avoir en tête certains tableaux de Max Ernst, images qui remontent d’ailleurs à des traditions bien plus anciennes, que l’on pense aux gargouilles gothiques, aux représentations infernales du Moyen-Âge ou à Jérôme Bosch.
Mais les descriptions de ces animaux par Etienne Ruhaud sont parfois tellement surchargées de détails hétéroclites que l’image formée dans la tête du lecteur finit par se brouiller un peu et qu’il ne nous serait pas forcément facile de dessiner ces créatures bizarres dans leur intégralité, si l’envie nous en prenait : signe que ces animaux sont avant tout littéraires et qu’il s’agit surtout, ici, de triturer les mots, de faire naître de l’inouï, de l’inattendu et de l’inconnu par la seule magie du langage.
Les effets de surprise se renouvellent quasiment à chaque phrase, avec un humour irrésistible qui nous prend au dépourvu, par un mélange d’absurde, de distorsions de notre réalité habituelle et le sentiment que l’auteur n’a pas de limite à son imagination.
Il y a sans doute dans ce livre un clin d’œil aux sciences naturelles, aux grandes classifications des naturalistes et autres zoologistes, avec ce souci des descriptions minutieuses et parfois chiffrées, mesurées, détournement ironique de l’esprit scientifique et de sa prétendue rigueur, qui participe grandement à l’humour de ces textes.
J’ai vraiment adoré ce recueil, qui m’a étonnée, amusée, divertie, et qui m’a permis d’explorer des zones imaginaires insoupçonnées, de me changer complètement les idées.
**
Page 17
LES CALOPLANS
Des animaux sympathiques, mais envahissants.
Soudé au mur, leur vaste corps plat se couvre d’une épaisse fourrure brune et soyeuse, très douce. Pas de face ni de gueule : juste deux immenses yeux gris, qui luisent dans l’obscurité et vous fixent intensément.
Nul ne sait de quoi ils se nourrissent. Les savants pensent qu’ils absorbent les micro-détritus, de minuscules créatures présentes dans l’atmosphère, grâce à de longues soies, sous l’abdomen.
Nul ne sait non plus comment ils se reproduisent, ni d’où ils viennent. Un beau matin vous vous levez : le caloplan est là, immobile, accroché à la paroi.
L’animal possède une certaine utilité, puisqu’il élimine poussières et miettes, chauffe la maison, émet un grondement strident en cas d’intrusion. Aspirateurs, radiateurs et alarmes deviennent ainsi superflus. De toute façon vous ne pouvez vous en débarrasser. D’une rare longévité, le caloplan reste attaché à la maison, et son organisme résiste à toute agression. En cas d’attaque, les yeux de la créature s’embuent de grosses larmes blanches, qui rongent le parquet dans une suffocation nauséabonde. En pleurant, le caloplan émet un signal vibratile insupportable, une sorte de long sanglot silencieux, brisant vitres et oreilles.
page 36
LES OURANIS
Mer perdue, flaque d’infinie tristesse. Miroir opaque, sans fond ni ciel.
Comme des nénuphars colorés, de petites îles circulaires éclairent la nuit océane. Au centre, la bouche, fleur écarlate – chair et sang -, secrète une drogue naturelle, aérienne. Autour, c’est une mousse rose, au parfum entêtant.
Irrésistiblement attirés vers le cœur, hommes et oiseaux périssent dans les étreintes vénéneuses de l’ourani. Les sucs de la plante dissolvent peau et entrailles.
Du corps ne restent qu’os noircis, échoués sur la grève, débris d’un songe cruel.
**