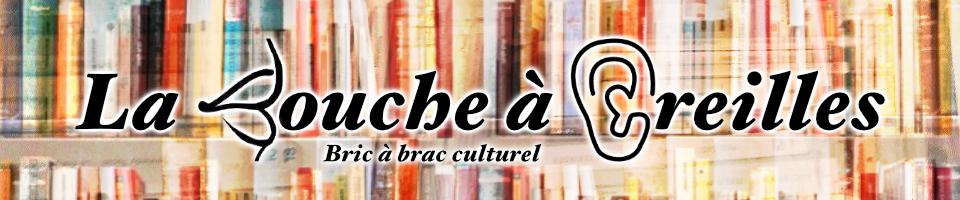J’ai lu cette pièce de théâtre dans le cadre des lectures autour de l’holocauste organisées par Patrice et Eva du blog « Et si on bouquinait un peu » et par « Passage à l’Est ».
Note biographique sur l’écrivaine
Charlotte Delbo (1913-1985) est une écrivaine française. Communiste et Résistante durant la deuxième guerre mondiale, elle a été déportée à Auschwitz-Birkenau de janvier 1943 à janvier 1944 puis à Ravensbrück de janvier 1944 à avril 1945. Son œuvre littéraire témoigne de son expérience des camps, par exemple dans Aucun de nous ne reviendra (1965) ou la pièce Ceux qui avaient choisi. Elle a été l’assistante de l’acteur et homme de théâtre Louis Jouvet. A la fin des années 50, elle a rompu avec ses convictions communistes de jeunesse.
Présentation de l’histoire
La pièce se déroule à Athènes. À une terrasse de café au début des années 60, un homme, seul à sa table, aborde une femme, seule à la table voisine, dans le but de la séduire ou en tout cas de faire connaissance. Cet homme est allemand et il se prénomme Werner. Il a fait des hautes études universitaires au sujet de la Grèce Antique et est devenu un professeur spécialiste de ce domaine. Durant la période de la guerre il était officier de l’armée allemande et a donc endossé l’uniforme hitlérien même s’il n’était pas un partisan d’Hitler et qu’il était plutôt un planqué sans aucune responsabilité ou activité significative. La femme, Françoise, est quant à elle une rescapée d’Auschwitz et son mari résistant a été torturé et fusillé par les allemands pendant la guerre. Une discussion s’engage entre les deux personnages et chacun explique son parcours et les choix qui ont été les siens dans les années 30 et 40.
Mon Avis
C’est une pièce de théâtre assez courte (environ 80 pages) et qui a une portée pédagogique évidente car elle expose beaucoup de faits historiques et d’idées générales d’une manière claire, précise et argumentée, en allant à l’essentiel.
Malgré ce côté didactique, les personnages ne sont pas caricaturaux, ils ne sont pas monolithiques, et nous ne sommes pas supposés détester le personnage de Werner, qui reconnaît lui-même qu’il s’est toujours davantage intéressé à l’histoire antique qu’à ses contemporains et qui nous donne l’image d’un désengagement complet vis-à-vis de son époque. Il n’était pas hitlérien pendant les années 30-40 mais il est quand même devenu officier allemand, avec le moins de responsabilité possibles. Il n’a pas voulu résister et n’a pas vraiment collaboré non plus. En discutant avec Françoise, il est prêt à reconnaître ses torts c’est-à-dire surtout sa lâcheté et sa totale négligence, mais Françoise ne cherche pas à l’accabler. Elle ne le déteste pas mais elle ne peut s’empêcher de le juger pour ce qu’il est, c’est-à-dire un mollasson, un homme sans caractère. Elle se dit qu’il aurait pu résister, s’engager, comme elle et son mari l’avaient fait, et même si cela les a exposés tous les deux à risquer leur vie.
Si Werner est professeur d’histoire grecque et spécialiste de littérature antique, ce n’est bien sûr pas un hasard. Il s’agit du rappel de nos origines européennes, du berceau de notre civilisation. Werner a baigné toute sa vie dans les idées de la démocratie athénienne, dans les idéaux de liberté et de vertu, mais il n’a absolument pas réagi lorsque Hitler est arrivé au pouvoir et a instauré la dictature ou quand les lois raciales ont été promulguées. Il a l’impression que Socrate et Homère sont morts avec Auschwitz. Mais c’est peut-être seulement lui-même, Werner, qui n’a pas été à la hauteur de cette culture. Il a cru que les idéaux devaient rester purement livresques, alors que Françoise a su les faire vivre à travers ses actions, les mettre en pratique et se battre concrètement pour elles.
Une belle pièce sur la responsabilité et sur l’engagement, que les adolescents et les adultes peuvent lire avec profit.
Un Extrait page 36
Werner.- Non, nous n’avions pas le choix. Notre destin était : mourir à la guerre ou survivre dans la honte. Nous avons été pris, comme dans un piège qui se refermait sur nous. Tout un peuple pris au piège, par sa faute, faute d’avoir imaginé jusqu’où cela irait une fois cette machine infernale mise en route. Chacun des survivants honteux se demande comment il compose avec lui-même, aujourd’hui. En tout cas, je me le demande, moi. En vain. Pourtant j’étais ici, presque heureux, tout à l’heure, dans cette nuit d’avril, soyeuse, vibrante.- Ils ont pris le parti du mensonge comme si c’était plus facile. Alors… c’est en protestation que je dis que j’étais nazi, car nous l’étions tous. Et aujourd’hui, personne ne savait. Personne n’était au courant. Personne n’est coupable, n’est-ce pas ?
Françoise.- Beaucoup le sont, pas tous, c’est impossible.
Werner.- Oh ! Madame…
Françoise.- Si je l’avais cru, je ne serais pas sortie des camps. J’aurais perdu la volonté de survivre. Il faut croire en l’homme pour vouloir vivre.
Werner.- Et maintenant, aujourd’hui, vous n’avez pas de haine ? Comment pouvez-vous ?